L’aube est à peine passée lorsque Naïma se dirige vers son étable, où une dizaine de vaches sont prêtes à fournir du lait frais. Vers 7 heures du matin, un collecteur intermédiaire se rend chez cette éleveuse sexagénaire pour acheter près de 150 litres de lait. Une fois récupéré, le produit est transporté sur des motos ou à bord de pick-up, parcourant plusieurs douars parfois pendant des heures, avant d’être livré dans des crémeries où les conditions d’hygiène laissent à désirer. Un circuit loin d’être sans conséquences sur la qualité du lait, ce produit si prisé par les Marocains et qui, depuis quelques semaines, se trouve au cœur d’une vive polémique.
Depuis début avril, des avertissements se multiplient sur un possible lien entre la consommation de lait cru et des cas de tuberculose. Tout a commencé avec des influenceurs diffusant sur les réseaux sociaux des images de ganglions enflés au niveau du cou, affirmant avoir contracté la maladie suite à la consommation de produits laitiers. Si ces déclarations restent pour l’instant non vérifiées, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a rapidement réagi, en assurant que «la sécurité du lait et de ses dérivés est garantie», tout en précisant «qu’il n’existe aucun risque de transmission de la tuberculose via des produits soumis à un contrôle sanitaire rigoureux et précis à chaque étape de la chaîne de production et de distribution».
L’Office a souligné que «le lait destiné à la consommation est suivi dès l’élevage des vaches, en passant par la collecte, le traitement dans des unités industrielles agréées, jusqu’à son arrivée aux points de vente soumis à une surveillance continue». Confirmant ces propos, Rachid Khattate, président de la Fédération interprofessionnelle «Maroc Lait», appelle à la prudence face aux informations relayées et affirme que la majorité des produits commercialisés au Maroc subissent des contrôles stricts par l’ONSSA. «Depuis la collecte chez l’agriculteur, leur transport, leur arrivée dans les usines où les citernes sont rigoureusement analysées, jusqu’à la pasteurisation ou la transformation en UHT, à des températures variant de 70° à plus de 140°, toutes les étapes sont maîtrisées», précise-t-il, soulignant que ces traitements industriels garantissent une qualité qui rassure le consommateur marocain.
Depuis début avril, des avertissements se multiplient sur un possible lien entre la consommation de lait cru et des cas de tuberculose. Tout a commencé avec des influenceurs diffusant sur les réseaux sociaux des images de ganglions enflés au niveau du cou, affirmant avoir contracté la maladie suite à la consommation de produits laitiers. Si ces déclarations restent pour l’instant non vérifiées, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a rapidement réagi, en assurant que «la sécurité du lait et de ses dérivés est garantie», tout en précisant «qu’il n’existe aucun risque de transmission de la tuberculose via des produits soumis à un contrôle sanitaire rigoureux et précis à chaque étape de la chaîne de production et de distribution».
L’Office a souligné que «le lait destiné à la consommation est suivi dès l’élevage des vaches, en passant par la collecte, le traitement dans des unités industrielles agréées, jusqu’à son arrivée aux points de vente soumis à une surveillance continue». Confirmant ces propos, Rachid Khattate, président de la Fédération interprofessionnelle «Maroc Lait», appelle à la prudence face aux informations relayées et affirme que la majorité des produits commercialisés au Maroc subissent des contrôles stricts par l’ONSSA. «Depuis la collecte chez l’agriculteur, leur transport, leur arrivée dans les usines où les citernes sont rigoureusement analysées, jusqu’à la pasteurisation ou la transformation en UHT, à des températures variant de 70° à plus de 140°, toutes les étapes sont maîtrisées», précise-t-il, soulignant que ces traitements industriels garantissent une qualité qui rassure le consommateur marocain.
Risque de maladie grave !
Tayeb Hamdi, médecin et expert en politiques et systèmes de santé, rappelle que la consommation de lait cru, c’est-à-dire non pasteurisé (chauffé à 60–70°C) ou non stérilisé (chauffé à 100°C), représente un danger réel, soulignant l'importance d’éviter les produits issus du circuit informel. «Même lorsqu’il provient de fermes contrôlées, avec des vaches vaccinées, un encadrement vétérinaire régulier et des normes d’hygiène respectées, le lait cru demeure un produit potentiellement porteur de maladies», explique-t-il. C’est pour cette raison que l’ONSSA insiste sur la consommation exclusive de lait provenant d’unités agréées, mettant en avant que «les produits sains peuvent être facilement identifiés grâce aux informations figurant sur leurs étiquettes, notamment le numéro d’agrément délivré par l’ONSSA et les mentions sanitaires apposées au dos de l’emballage».
Reste à comprendre pourquoi le circuit informel perdure. Pour Naïma, la réponse est simple : les collecteurs viennent chaque jour avec du cash en main. «Le gain est plus rapide et il n’y a pas de complications administratives», souffle-t-elle. En vendant leur production aux collecteurs informels, les éleveurs bénéficient ainsi d’une liquidité immédiate, essentielle pour répondre à leurs besoins quotidiens, contrairement au circuit formel qui impose souvent des délais de paiement. De plus, ces collecteurs tolèrent des niveaux de qualité variables et ne nécessitent pas d’investissements lourds, tels que des tanks de refroidissement ou des analyses de qualité. «Dans certaines régions, nous proposons des prix légèrement supérieurs à ceux offerts par les laiteries, en raison de la forte demande urbaine pour le lait cru», confie un collecteur que nous avons croisé lors du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM). Cette situation demeure néanmoins précaire, exposant les éleveurs à une absence de protection juridique, tout en mettant en danger les consommateurs et en limitant la capacité des producteurs à valoriser durablement leur production. Si le circuit informel répond à des besoins économiques immédiats, il enferme également les petits producteurs dans une logique de survie, au détriment de leur intégration dans des filières formelles et pérennes.
L’encadrement s’impose
Face à cette situation, Ahmed Boukrizia, président de la Fédération des producteurs de viandes, de lait et de produits agricoles, plaide pour une intégration graduelle, mais surtout flexible, du secteur informel. Selon lui, il est nécessaire d’imposer d’abord des autorisations sanitaires obligatoires pour tous les producteurs et collecteurs de lait. Il estime également que les transporteurs de lait doivent être formés aux bonnes pratiques d’hygiène et que leurs équipements de transport doivent être régulièrement contrôlés et agréés. L’utilisation de conservateurs non autorisés doit par ailleurs être prohibée, avec des contrôles stricts pour garantir l’usage exclusif de produits approuvés. Des points partagés par Rachid Khattate, qui insiste sur la nécessité de renforcer les contrôles de la part des autorités publiques, soulignant que l’enjeu est de maintenir la confiance du consommateur envers les produits locaux.
En effet, face aux dangers que représente la consommation de lait cru, l’État a un rôle déterminant à jouer dans la régulation du secteur laitier, notamment en matière de contrôle vétérinaire des élevages, d’encadrement médical des agriculteurs, de surveillance rigoureuse des chaînes de production, de stockage et de distribution, et de lutte contre la vente sauvage de lait non contrôlé. Toutefois, au-delà des actions publiques, une sensibilisation renforcée de la population s’impose, rappelle Tayeb Hamdi. De nombreuses personnes consomment du lait cru en croyant préserver leur santé, sans réaliser les risques encourus. Or, même lorsque le lait provient d’une ferme réputée pour sa rigueur sanitaire, il ne doit pas être consommé sans être préalablement bouilli ou pasteurisé.
La croyance selon laquelle le lait cru serait plus «naturel» ou plus bénéfique est dangereuse. Quelle que soit son origine, la consommation de lait cru reste risquée pour la santé humaine, particulièrement lorsque ce lait est acheté sans traçabilité, sans contrôle vétérinaire et sans garantie de traitement thermique.
3 questions à Ahmed Boukrizia : «Les coopératives et les centres de collecte informels devraient être soumis à une réglementation rigoureuse»
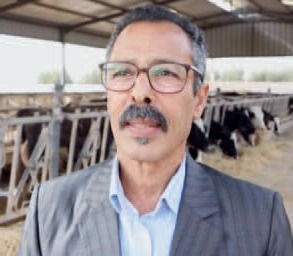
Président de la Fédération des producteurs de viandes, de lait et de produits agricoles, Ahmed Boukrizia répond à nos questions.
- Pouvez-vous nous expliquer les principales étapes du circuit du lait cru, depuis sa collecte à la ferme jusqu'à son arrivée chez le consommateur, notamment en dehors du circuit industriel formel ?
- Dans le circuit industriel formel, le processus commence par la collecte du lait dans les exploitations agricoles ou les coopératives. Les éleveurs y nourrissent leurs vaches avec des aliments de qualité, fournis par des entreprises agréées par l’ONSSA. Le cheptel est suivi de près par des vétérinaires, qui veillent à sa santé et assurent la vaccination contre les maladies contagieuses. Lors de la traite, les pis des vaches sont soigneusement nettoyés et le lait est recueilli dans des récipients propres, avant d’être rapidement réfrigéré pour éviter toute détérioration. En revanche, dans les circuits parallèles informels, la collecte et le transport du lait s’effectuent dans des conditions sanitaires précaires. Le lait est souvent recueilli dans des contenants en plastique non désinfectés et transporté, parfois pendant plusieurs heures, sur des motos ou des pick-up, à travers différents douars. Il est ensuite livré dans des crémeries où les normes d’hygiène ne sont pas toujours respectées, exposant ainsi les consommateurs à des risques sanitaires réels.
- Quels sont aujourd’hui les moyens utilisés par les acteurs informels pour traiter ou conserver le lait cru, et dans quelle mesure ces pratiques respectent-elles les normes d’hygiène de base ?
- Les acteurs informels utilisent des méthodes de conservation du lait qui restent largement en dehors des normes d’hygiène de base. Le lait est souvent transporté sans réfrigération immédiate, dans des contenants en plastique non désinfectés, favorisant ainsi la prolifération des bactéries. Pour prolonger la durée de conservation, certains n’hésitent pas à ajouter des conservateurs chimiques, pourtant nocifs pour la santé. Le transport, qui peut durer plusieurs heures sur des motos ou en pick-up, aggrave encore les risques de contamination et de détérioration du lait. Ces pratiques s’éloignent considérablement des standards requis pour garantir la sécurité alimentaire.
- À votre avis, quelles solutions pourraient être envisagées pour encadrer et intégrer légalement ces circuits parallèles, tout en garantissant la sécurité sanitaire du lait distribué ?
- Pour intégrer légalement ces circuits parallèles tout en assurant la sécurité sanitaire du lait, il faudrait déjà rendre obligatoire l’obtention d’une autorisation sanitaire pour tous les producteurs et collecteurs de lait. Les transporteurs, de leur côté, devraient recevoir une formation aux bonnes pratiques d’hygiène, et leurs équipements de transport devraient faire l’objet de contrôles réguliers et d’agréments spécifiques. L’usage de conservateurs chimiques non autorisés doit être strictement interdit, avec des inspections renforcées pour garantir le respect des règles. Les coopératives et les centres de collecte informels devraient être soumis à une réglementation rigoureuse en matière de nettoyage, de stockage et de transport, avec des infrastructures agréées et régulièrement contrôlées. Si certaines de ces démarches ont déjà été initiées par l’ONSSA, il est impératif de les renforcer pour protéger efficacement la santé des consommateurs, quel que soit le circuit de distribution du lait.
3 questions à Rachid Khattate : « Le lait informel n’est pas cher, mais la qualité et la sécurité ne sont absolument pas garanties »

Rachid Khattate, président de la Fédération interprofessionnelle «Maroc Lait», répond à nos questions.
- La crise laitière fait encore polémique sur les réseaux sociaux. Comment distinguer le vrai du faux ?
- Effectivement, de nombreuses informations circulent sur les réseaux sociaux, notamment concernant des cas supposés d'infections à la tuberculose animale liés à la consommation de lait. À notre niveau, nous n’avons reçu aucune confirmation officielle sur la véracité de ces cas. Il est clair qu’il existe une part d’inquiétude, alimentée par des rumeurs ou de fausses informations.Nous tenons à rassurer les consommateurs que tout le lait produit sous autorisation de l'ONSSA suit des procédures strictes de contrôle sanitaire. Depuis la collecte chez l’agriculteur jusqu’à son transport et son arrivée en usine, le lait est soumis à des analyses rigoureuses. Ensuite, il est pasteurisé ou transformé en lait UHT, selon des procédés atteignant des températures de 70° à plus de 140°C. Ces traitements garantissent une qualité sanitaire optimale. Heureusement, les consommateurs marocains sont de plus en plus avertis et savent faire la part des choses face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux.
- Mais le lait du secteur informel reste bel et bien présent…
- Oui, c’est indéniable. Le lait vendu dans les circuits informels n’est soumis à aucun contrôle de qualité. Il n’est ni testé pour sa composition ni traité thermiquement (pas de pasteurisation ni de stérilisation). Il est recueilli directement après la traite, parfois à partir d'animaux (vaches, chèvres ou brebis) qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification sanitaire, puis transporté à travers des chaînes totalement non réglementées. La persistance de ce circuit informel s’explique principalement par le prix attractif du lait brut, mais c’est aussi là son seul véritable avantage. La qualité et la sécurité sanitaire, elles, ne sont absolument pas garanties.
- Au-delà de cette crise, le secteur laitier fait face à des défis structurels, notamment depuis la pandémie de Covid-19, en particulier concernant le cheptel. Quelles mesures avez-vous mises en place pour y faire face ?
- L'année 2025 sera décisive pour la relance du secteur laitier. Nous devons redoubler d’efforts pour reconstituer le cheptel, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. L’objectif est d'améliorer génétiquement un cheptel affaibli par plusieurs années de sécheresse et par l'absence de textes juridiques encadrant correctement l’insémination artificielle. Dans cette perspective, la Fédération interprofessionnelle du secteur laitier a conclu trois conventions avec le ministère de l’Agriculture, dans le cadre du contrat-programme 2024-2026 pour le développement du secteur.Ces conventions visent plusieurs objectifs, notamment assurer une formation continue des producteurs et transformateurs membres de la fédération, équiper et restructurer les circuits d’insémination artificielle, et renforcer le contrôle de la qualité du lait à l’échelle nationale. Nous avons également lancé la création d’unités régionales pour encadrer les membres sur le terrain et garantir la mise en œuvre effective de la stratégie "Génération Verte", qui est un pilier majeur pour l’avenir du secteur.















![Lait contaminé : Les périlleuses mamelles de l’informel [INTÉGRAL] Lait contaminé : Les périlleuses mamelles de l’informel [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/grande/88221552-62489181.jpg?v=1745921252)
![Lait contaminé : Les périlleuses mamelles de l’informel [INTÉGRAL] Lait contaminé : Les périlleuses mamelles de l’informel [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/default/88221552-62489181.jpg?v=1745921253)









